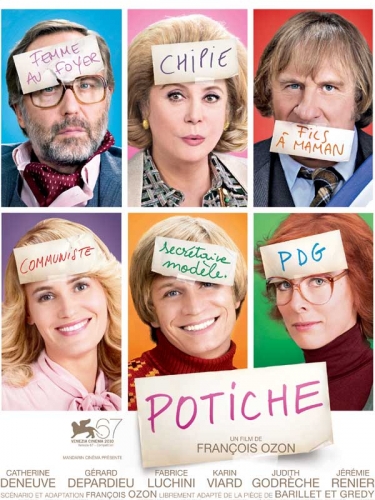TRUE GRIT de Joel Coen et Ethan Coen ****









Venger son père assassiné par un coward pour deux pièces d'or n'est pas simple dans le big west-ern de l’après guerre de Sécession, qui rappelons le cessa faute de combattants. Et puis comment être prise au sérieux quand on est une petite fille de 14 ans terrassée et indignée ? Mais Mattie Ross (magnifiquement interprétée par la petite Haylee Steinfeld qui ne manque pas de true grit) va mettre son chagrin en veille et, consciente que la justice ne punira pas le coupable, chercher l'homme idéal qui se chargera de la sale besogne. Elle trouve en Rooster Cogburn, marshall borgne et alcoolique mais réputé pour son obstination et son taux de réussite, le vengeur parfait. Par ailleurs, elle va croiser la route du Texas Ranger LaBoeuf, lui aussi à la poursuite de l’infâme Tom Chaney recherché dans un autre Etat pour d’autres méfaits. La motivation de LaBoeuf est la récompense conséquente promise. Les deux hommes vont s’engager en territoire indien où l’immonde Chaney s’est refugié. Ils seront vite rejoints par la fillette qu’ils avaient essayé de semer. Impressionnés par son courage et sa détermination ils vont finalement accepter qu’elle fasse partie du voyage sans pour autant la traiter avec le moindre égard. L’aventure peut commencer. Alors évidemment c’est l’histoire d’une gamine intelligente et cultivée qui n’a pas froid aux yeux et qui n’hésite pas un instant à affronter des hommes qui la regardent de haut, d’un œil goguenard, pour ne pas dire patelin. C’est macho à souhait, mais c’est finalement cette petite minette tenace et téméraire qui va venir à bout de sa soif de justice qui tourne à l’obsession. A un prix considérable certes mais sur son chemin initiatique, Mattie aura côtoyé deux hommes qui marqueront sa vie à tout jamais. Car dans ce film, ce n’est pas tant le résultat qui importe, mais le chemin pour y parvenir. Ce n’est pas tant la vengeance qui intéresse et stimule le spectateur mais la façon dont elle est menée. Pas tant l’intrigue qui captive que la rencontre entre les personnages. L’essentiel n’est pas pourquoi ils sont ensemble mais qu’ils soient ensemble. C’est tout. Et c’est beau ! La tension et les rebondissements ne font pas obstacle à une certaine nonchalance toujours bienvenue dans un western je trouve. Comme si le temps était différent dans le grand ouest. Les personnages prennent toujours le temps d’installer un campement de fortune, de dormir à la belle étoile (images somptueuses de nuit !) autour d’un feu de camp à « déguster » du maïs bouilli. C’est quand il ne se passe rien que tout se joue, que les liens se resserrent, que les regards et les attentions s’expriment. L’aisance et la confiance en soi de la petite, son insouciance, son ignorance du danger sont toujours en décalage avec l’immaturité des hommes souvent en compétition. Face à elle, à sa fraîcheur, sa jeunesse et sa franchise, il y a donc ce marshal borgne qui se fait sans doute plus vieux qu’il n’est (et Jeff Bridges avec sa voix râpeuse y va très très fort) toujours totalement imbibé d’alcool jusqu’au fond des yeux, et LaBoeuf (Matt Damon, une fois de plus extraordinaire !) Texas Ranger un peu précieux aux éperons à grelots décoré comme un cow-boy d’opérette. Et là encore, les Coen ne cède pas à la facilité d’une pseudo relation pères de substitution/fille, même si dans une scène somptueuse le vieux Cogburn lui portera secours. Et malgré l’humour qui est évidemment le petit cadeau supplémentaire, la conclusion pleine de mélancolie voire de tristesse laisse le westernien tout morose. Pour être totalement impartiale je révèlerai néanmoins deux petites déceptions à mon emballement. Le film met un peu de temps à démarrer. Sans doute étais-je trop pressée de voir l’improbable trio prendre la piste vers le territoire indien où s’est réfugié l’affreux. Et inversement la fin, trop abrupte nous prive de façon expéditive des trois personnages avec qui j’aurais bien continué encore le chemin jusqu’à d’indispensables retrouvailles…
Par manque de temps et à cause d’une petite forme je ne pourrai sans doute pas vous exprimer le quart du millième de ce que la vision de ce film m’a provoqué mais il FAUT que je vous en parle un peu avant que vous ayez choisi de voir d’autres films. J’ai l’impression que les frangins Coen (que leur maman doit être fière !!!) flirtent depuis des lurettes avec le western. Mais enfin, ici, ils y tombent pieds et poings liés et y reprennent tous les codes incontournables. Modestement ou intelligemment ou simplement en fans, ils ne cherchent pas à révolutionner la vision de l’Ouest post guerre civile, mais en offrent au contraire une vision tout à fait classique. Et gloire leur soit rendue pour ça. Pour ne pas avoir tenté de nous imposer un néo-western, essayer de nous faire croire qu’ils avaient inventé un genre alors qu’il est né pratiquement en même temps que le cinéma. Evidemment, en frères Coen qu’ils sont, ils ne situent pas leur intrigue en plein cagnard mais en hiver. Cela rend la chevauchée encore plus éprouvante mais n’atténue en rien la splendeur des paysages de la région parcourue, au contraire.