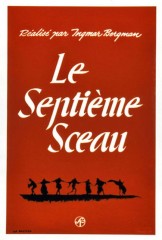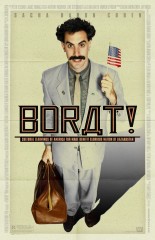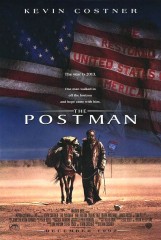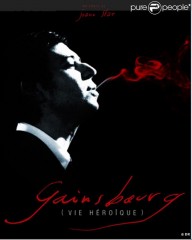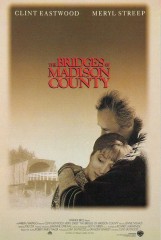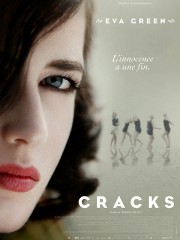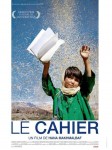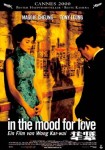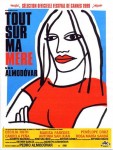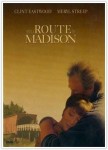Dans la famille Strobbe il y a quatre frères qui vivent chez leur maman, une femme usée mais d’une patience admirable avec ses quatre garçons chômeurs, fumeurs, buveurs, dragueurs. Mais il y a surtout Gunther, 13 ans, le fils de l’un d’entre eux. Il aime sa famille, son père mais aimerait pouvoir se sortir de cette condition fatale qui semble frapper les hommes de la famille.
Tourné en alternance entre passé et présent, on découvre Gunther adulte, en passe de devenir père à son tour sans le vouloir, comme son père avant lui. Il envisage de quitter la fille enceinte qui l’aime et puis finalement revient vivre avec elle. Dans le roman qu’il est en train d’écrire il raconte son enfance et plus précisément cette année de ses 13 ans où il a pris conscience de l’absolue « merditude des choses ». Il note qu’il déteste deux femmes au monde plus que tout : celle qui lui a donné la vie et celle qui va le faire devenir père.
Le réalisateur n’y va pas avec le dos de la cuillère, ni même de main morte avec le réalisme cru pour dépeindre cette famille, leur environnement, leur quotidien. Et si je n’avais moi-même vécu de longues années en « Flandrie » dans un quartier très très populaire plein de briques rouges... (un pied de chaque côté de la frontière pour faire vite…) je dirais que Félix Van Groeningen exagère et qu’il pousse un peu loin la satire ou la caricature. Hélas non, ces affreux, sales, très bêtes mais pas méchants, je les ai croisés, ils existent. Et comme pour le paradoxe insoluble de l’œuf et de la poule, on ne sait ce qui est véritablement à l’origine de cette mouise intégrale. Est-ce qu’ils boivent parce qu’ils sont au chômage ou est-ce qu’ils sont au chômage à force d’avoir trop bu ? Ou est-ce qu’ils boivent pour oublier qu’ils boivent ? L’énigme ne sera pas résolue. C’est un fait, voilà.
Ce film c’est un peu l’anti « Bienvenue chez les Chtis » parce qu’ici pas de bons et nobles sentiments. Pas de niaiserie du style « les gens du Nord ont dans le cœur le bleu qui manque à leur décor ». Les frites sont grasses, la bière brune coule à flot, les gosses se baignent dans la rivière avec des pneus en guise de bouée et on organise le championnat mondial de beuverie sous les applaudissements des habitants de la ville et des enfants qui trinquent pendant que leurs parents boivent. Ne pas être sélectionné pour ce concours où l’on finit, au mieux le nez dans son vomi, au pire dans le coma, est une désolation qu’on peut oublier… en buvant. Une autre distraction est la course à vélo complètement nu qui réjouit les autochtones.
Etrange film donc. Parfois drôle lorsque les trois malabars privés de télé s’invitent chez un voisin iranien qui vient d’emménager parce que leur idole Roy Orbison passe à la télé. Il faut voir ces grosses brutes pas très reluisantes se trémousser ou pleurnicher sur « Only the lonely » ou « Pretty woman » !
J’imagine que dit comme ça, ce film à de quoi faire fuir. Mais passée la surprise qui fait des personnages de Ken Loach et de leurs galères de véritables apprentis face à ces professionnels de la mouscaille, après quelques sourires, quelques écoeurements aussi, le cœur est curieusement étreint par l’humanité poisseuse qui emplit et déborde de chaque scène. Et on rêve que Gunther s’en sorte sans passer pour un traitre.
La Merditude des choses est adapté d'un best-seller de Dimitri Verhulst intitulé De Helaasheid der Dingen. Ce récit autobiographique avait fait beaucoup de bruit lors de sa publication en 2006. Les lecteurs flamands et néerlandais l'ont accueilli comme la sensation littéraire des années 2000 et il a été récompensé par de nombreux prix littéraires. Il a été traduit en plusieurs langues.